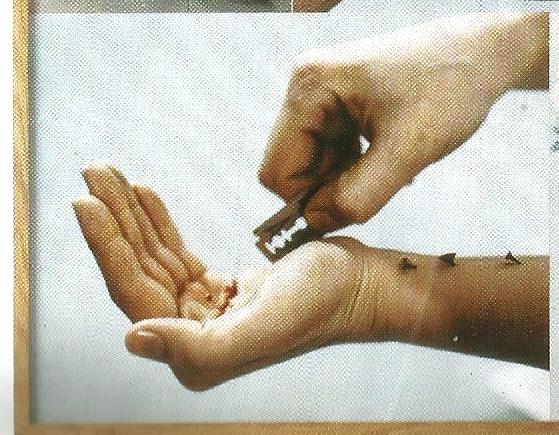|
||
|
L’ATELIER PHILO…
Historiquement, « l’atelier
philo » s’inscrit à la fois dans la continuité et la rupture des « cafés
philo » des années 1995-2005.
-
Dans
la continuité, car il ne s’agit pas de conférence, ni d’exposé, (même suivi d’un
débat), de la part de quelqu’un qui, possesseur d’un savoir, viendrait le transmettre ;
chaque participant, quelle que soit sa compétence, s’exerce à exprimer son propre
point de vue, sur lequel il permet ainsi, à chacun, d’opérer un travail de
compréhension et de critique.
-
Dans
la rupture aussi, par conséquent, car ce travail en commun devient l’aspect principal
de l’atelier.
|
||
|
"ECHO"... à :
Pas d'histoire sans transcendance » Atelier Philo du 1er Mars 2022 La Théologie et la Métaphysique semblent s'être appropriées le problème de la transcendance : « foi » et « croyance » font cesser le « doute » propre à la raison. La Théologie assoit la « vérité » de la Religion ; la Métaphysique assoit celle d'un système Philosophique ; les deux affirment l'existence de la « Transcendance », qu'elle soit un Dieu, un Etre suprême, ou un Absolu. Quant à l'histoire, une fois posée l'existence de la transcendance, il va alors de soi qu'elle n'est plus qu'affaire de raisonnement : « Insuffisance ontologique du monde » [Brahim] ; « le monde n'est pas cause de l'univers » [David] etc... Mais si la « Foi » et la « Croyance » restent le privilège de certains, reste à déterminer ce qui me permet d'établir une vérité ? Le sens commun : état mental de conviction pris comme fournissant un savoir ? L'intersubjectivité ? La correspondance entre le langage et le monde (expérience) [Laurent] ? Ou, tout simplement l'établissement d'un système de références propre à un groupe social ? Au final, qu'est-ce qui me permet d'accorder un crédit à la notion de « Transcendance » ? Tout d'abord, peut-être faut-il quitter cette idée spontanée de « supériorité » qui lui est attachée et ne garder que la notion « d'en-dehors » [Alicia]. Or si certains s'installent dans l'au-delà du monde physique (métaphysique), d'autres préfèrent, après le développement de la Science, s'en tenir au monde physique du temps et de l'espace : l'homme au sein de la nature avec laquelle il ne se confond pas (transcendance), aux prises tout à la fois, d'une relation à l'autre qui le constitue ( transcendance/intentionnalité) et d'un esprit qui est dans la recherche d'un ordre, d'un projet,. (transcendance/Sens). Or, force est de constater qu'aucune de ces « transcendances » n'est stable : le monde physique, la nature se transforment ; le rapport de l'homme à la nature (connaissance et action), le rapport de l'homme à son corps, le rapport de l'homme à l'altérité ( l'Humain ?) évoluent. Est-ce à dire qu'il s'agisse de « progrès » ? Pour parler de progrès, il faudrait effectivement que soit posée, pensée, une valeur « absolue » (transcendance) vers laquelle tendrait cette évolution . Sans doute est-ce la préoccupation des idéologies qui, ainsi, en se rapprochant de la Religion, quittent la philosophie. Quoi qu'il en soit, l'homme semble bien un créateur : empoignant le passé, il ne semble que bien rarement renoncer à se projeter dans l'avenir, grâce à l'ordre que sa volonté instaure dans son présent. Mais le Monde humain est vaste, divers, plein d'énigmes, plein de contradictions. Les choix des hommes, pas forcéments tout à fait libres, sont parfois étonnants, impressionnants. La chèvre de monsieur Seguin, éprise de liberté, n'a-t-elle pas finie mangée par le loup ? Histoire, éternel recommencement ? L'histoire accrochée à une « Belle » transcendance ? Peut-être ! Accrochée au tragique, sûrement... Geneviève
|